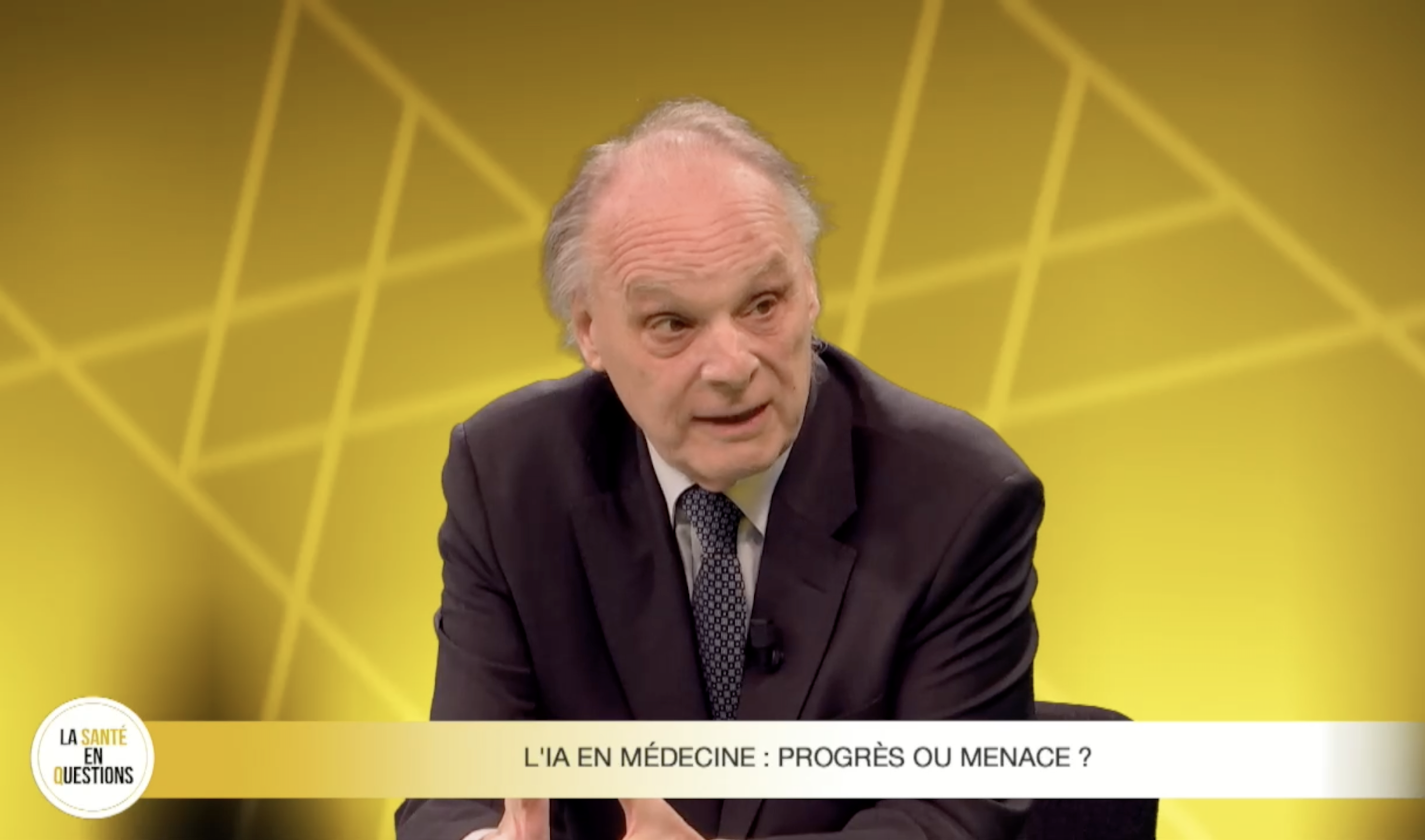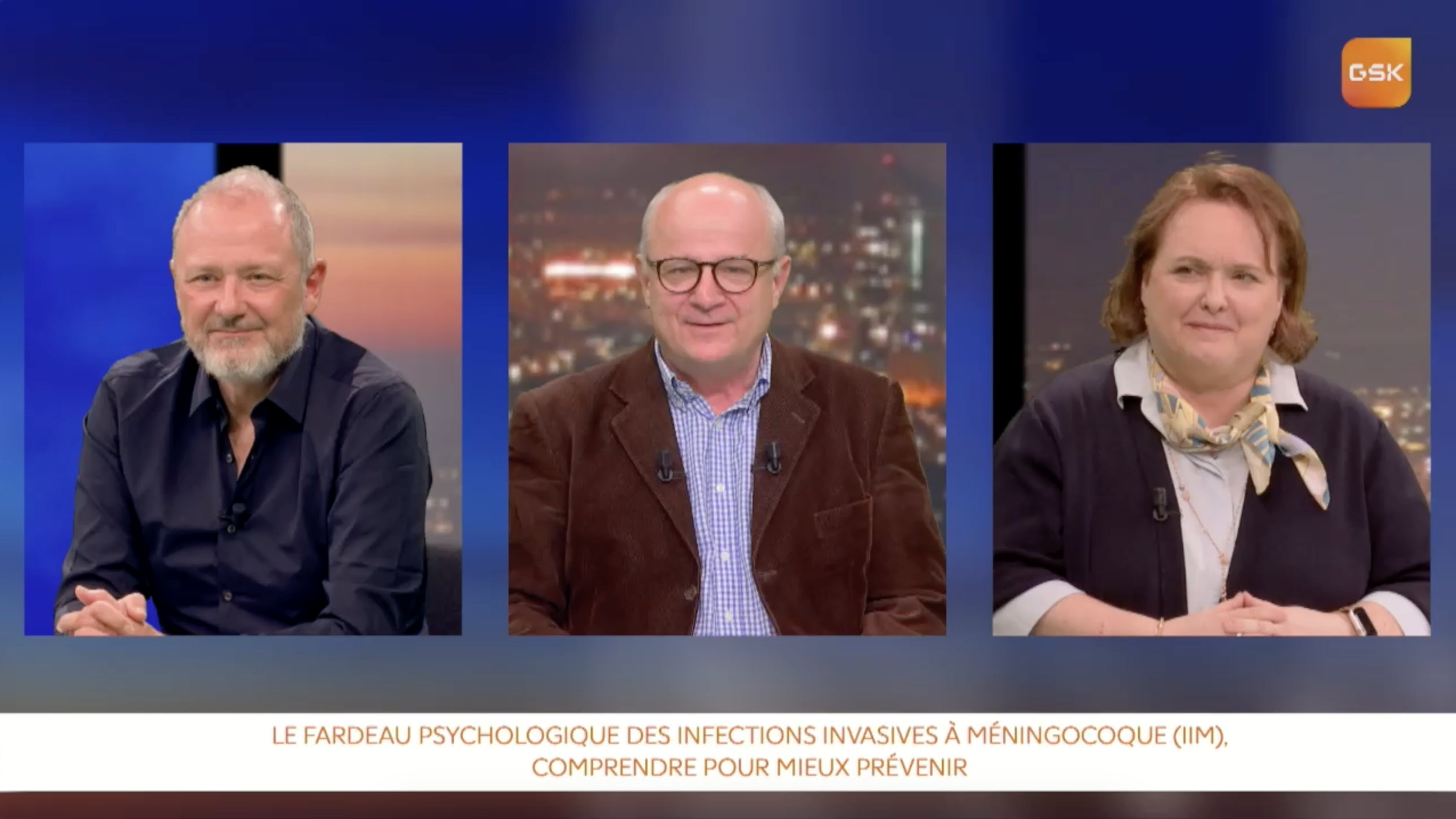Hépatologie
Cirrhose compliquée : les iSGLT2 seraient des diurétiques plus intelligents
Chez plus de 10 000 cirrhotiques compliqués et traités par spironolactone et furosémide, l’adjonction d’un inhibiteur du SGLT2 réduirait de 32% le risque composite ascite, varices, hyponatrémie et mortalité à 3 ans (HR = 0,68), tout en diminuant le recours aux ponctions d’ascite et le syndrome hépatorénal. Aucune alerte majeure de tolérance n’est ressortie de ce suivi rétrospectif multicentrique.

- Shidlovski/istock
L’inhibition rénale du SGLT2 provoque glucosurie et natriurèse avec modulation négative du système rénine-angiotensine-aldostérone, mécanismes déjà mis à profit dans l’insuffisance cardiaque. Or la cirrhose décompensée partage les mêmes problématiques de surcharge hydrosodée et d’activation système rénine-angiotensine.
Dans une cohorte TriNetX (120 structures, 2013-2024), 5310 adultes recevant un iSGLT2 (majoritairement empagliflozine ou dapagliflozine) ont été appariés à 5350 témoins par score de propension (âge 64 ans, 58 % d’hommes, diabète 71 %). Selon les résultats publiés dans le JAMA Network Open, à trois ans, le critère primaire composite (ascite, varices, hyponatrémie et mortalité) est survenu chez 28 % des témoins contre 20 % des exposés ; la survie sans événement est ainsi passée de 56 % à 66 %, HR ajusté 0,68 [0,66-0,71] ; p < 0,001.
Inhibiteur du SGLT2 : moins d’ascite, moins d’hospitalisations
L’usage d’un iSGLT2 s’est accompagné d’une réduction significative du syndrome hépatorénal (HR 0,47), du risque de péritonite bactérienne spontanée (0,55), de nombre de ponctions d’ascite (0,54) et des hémorragies par varices œsophagiennes (0,79). Les hospitalisations toutes causes confondues baissent d’un tiers (HR 0,67).
Chez les patients relativement compensés (MELD ≤ 15), le bénéfice se maintient pour le critère composite (HR 0,82) et pour le recours à la paracentèse, tandis qu’aucune surmortalité ou majoration d’encéphalopathie n’a été constatée. Les hypoglycémies sont moins fréquentes (0,75). Aucun signal accru d’infection urinaire ou d’acidocétose euglycémique n’a émergé, mais ces événements étaient trop rares pour une analyse robuste.
Vers un repositionnement dans la cirrhose du foie des iSGLT2
Basée sur des codes CIM-10, l’étude est sujette aux biais habituels de classification et à la nature rétrospective des dossiers analysés. Le double appariement et les tests de falsification (ostéoporose, gastro-entérite) minimisent toutefois la confusion résiduelle. Les résultats de cette analyse reflètent essentiellement la situation des cirrhotiques avec diabète ou insuffisance cardiaque, populations déjà candidates aux iSGLT2 ; l’extrapolation aux patients sans comorbidité métabolique doit donc être confirmée. La cohérence interne, baisse concomitante des ascites et des hospitalisations, renforce la plausibilité physiopathologique : diurèse osmotique, freinage du SRA et éventuelle action anti-fibrosante via la diminution des cytokines IL-6 et TNF-α.
Selon les auteurs, l’ajout d’un iSGLT2 pourrait être envisagé chez les cirrhotiques sous double traitement diurétique avec ascite réfractaire ou hyponatrémie, après évaluation du risque d’hypovolémie et de néphropathie diabétique. Des essais prospectifs randomisés doivent préciser les éléments suivants : la cinétique du sodium et du volume ascitique ; la sécurité rénale et métabolique dans ce contexte et l’éventuel effet-classe versus les différences moléculaires. Si ces données se confirmaient, les iSGLT2 rejoindraient les bêta-bloquants non sélectifs et l’albumine parmi les stratégies pharmacologiques capables d’infléchir le pronostic de la cirrhose décompensée.



-1527858813.jpg)