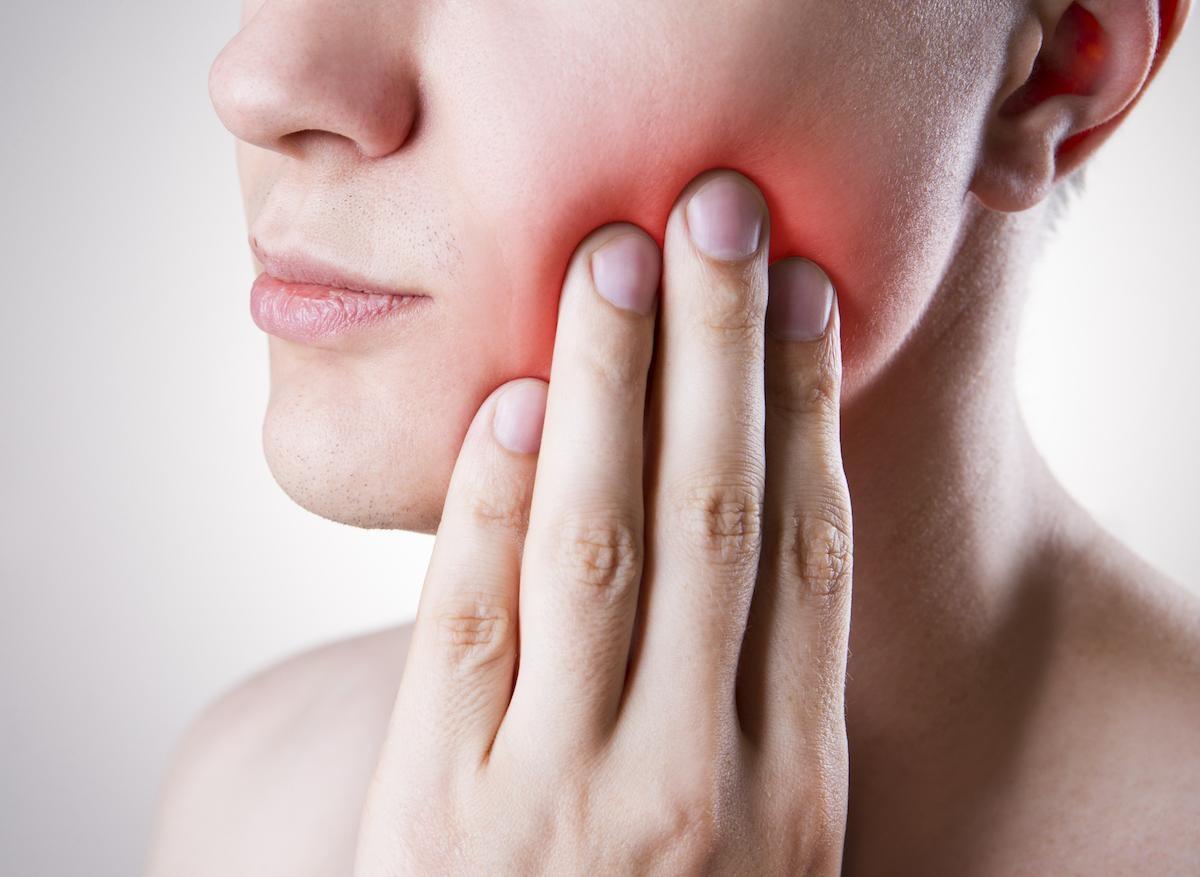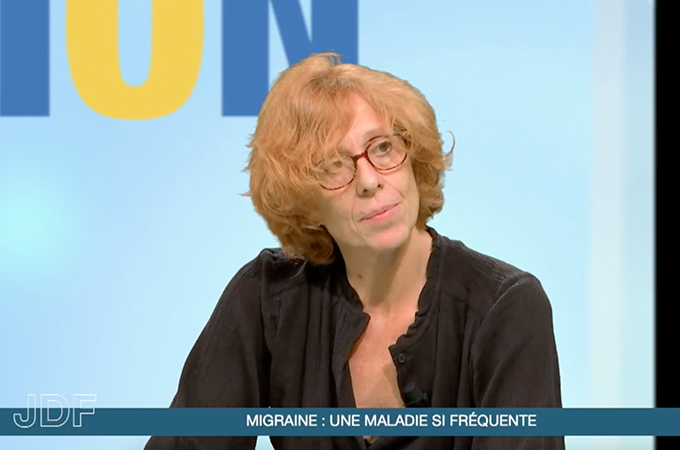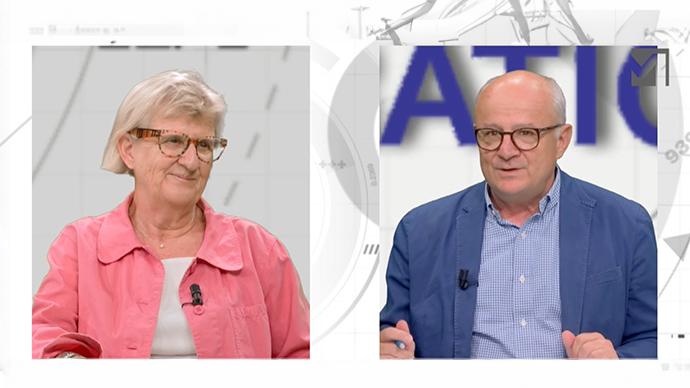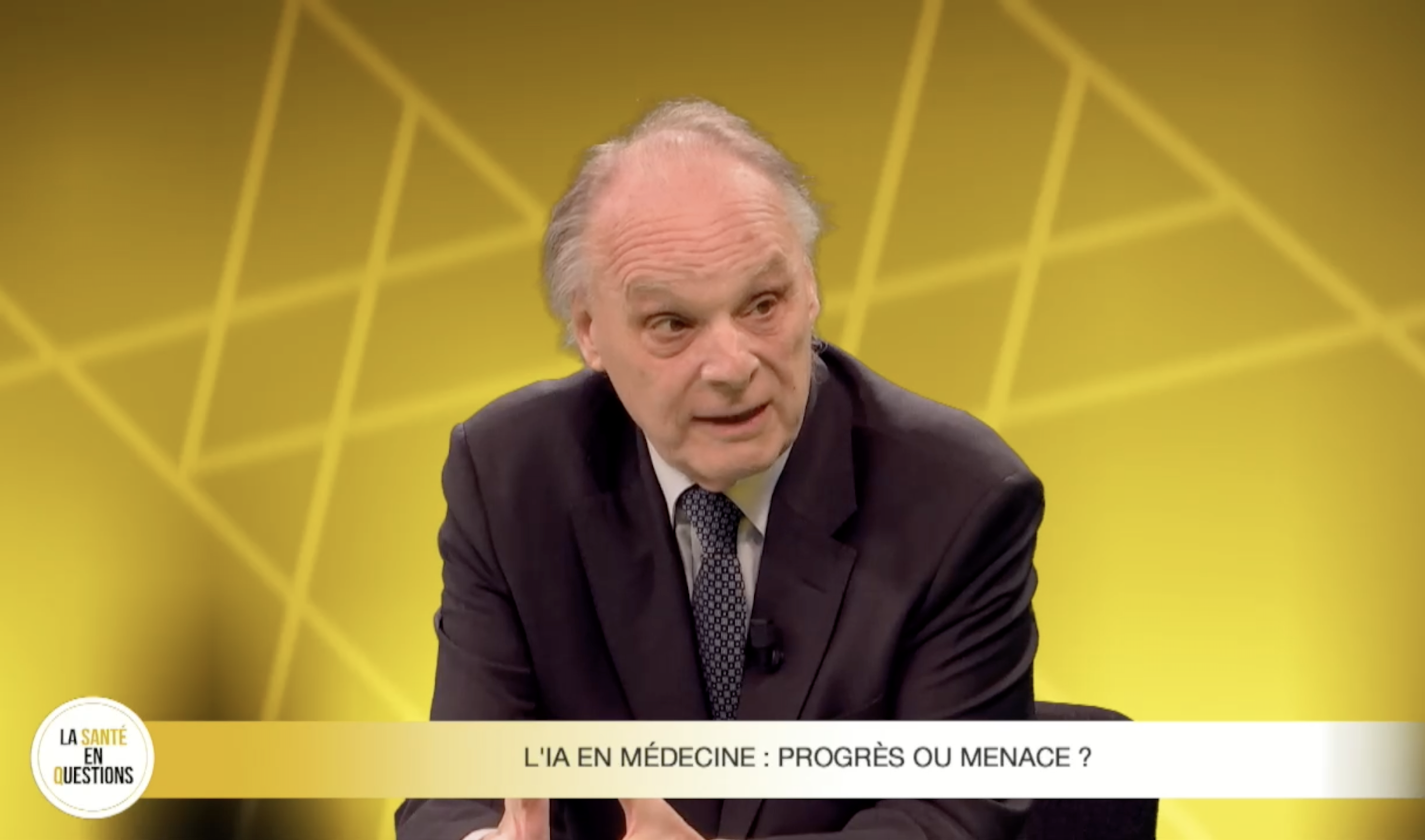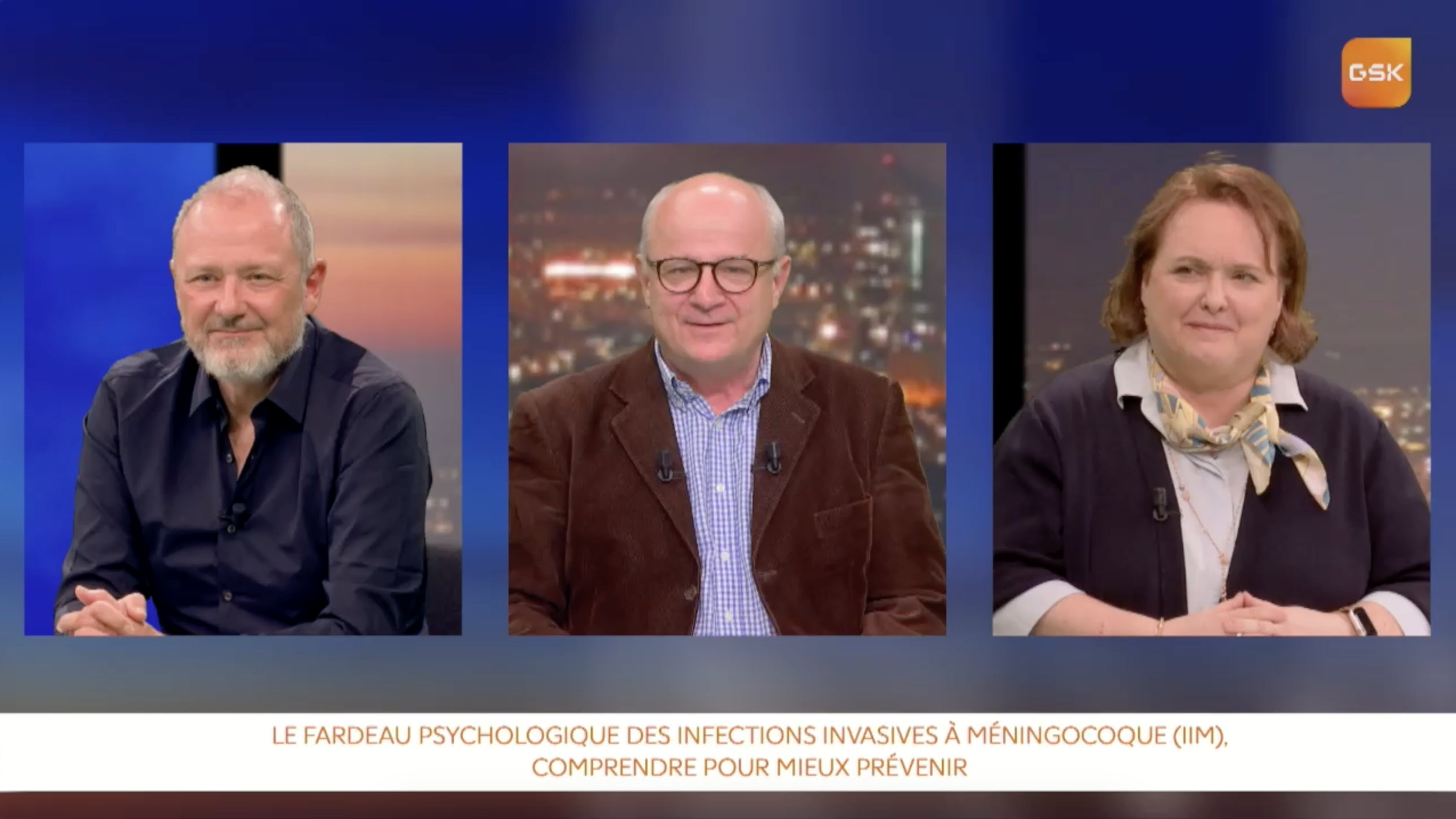Gériatrie
Dépression de la personne âgée : l’inflammation chronique en triple le risque
Chez les plus de 60 ans, l’inflammation chronique multiplierait par trois l’intensité et la durée de la symptomatologie dépressive lorsqu’il existe un trouble du sommeil. Les personnes âgées avec un mauvais sommeil bénéficieraient d’un traitement de cette inflammation.

- Ridofranz/istock
La prévalence annuelle d’un épisode dépressif majeur dépasse 10 % après 60 ans et s’accompagne de déclin cognitif et de surmortalité. Parallèlement, l’insomnie et l’inflammation chronique constituent deux facteurs indépendants de risque dépressif. Pour vérifier leur synergie pathogène, un essai randomisé contrôlé, en parallèle et en simple insu d’évaluateur, a exposé 160 adultes non déprimés (âge moyen 66 ans) soit à l’induction d’une inflammation par une endotoxine (0,8 ng/kg), soit à un placebo salin, après stratification selon la présence d’un trouble du sommeil (53 cas).
Selon les résultats publiés dans le JAMA Psychiatry, chez les sujets insomniaques ayant reçu l’endotoxine, le score de la sous‑échelle dépression du Profile of Mood States (POMS‑D) a bondi de façon significativement plus marquée que chez les bons dormeurs (interaction condition × groupe : F = 4,7 ; p < 0,001), avec un pic trois fois supérieur et persistant au‑delà de six heures, alors qu’il restait transitoire dans le groupe contrôle.
Une réactivité dépressive et inflammatoire surmultipliée
Au‑delà de l’auto‑évaluation, l’observation clinique confirme la tendance : l’inflammation induite par l’endotoxine majore les symptômes dépressifs cotés par l’examinateur (POMS‑D observateur F = 5,5 ; p = 0,001) et place les échelles MADRS et HAM‑D dans la zone de dépression légère, uniquement chez les insomniaques.
Les cytokines pro‑inflammatoires (IL‑6, TNF‑α) s’élèvent de façon comparable dans les deux groupes, mais la corrélation entre pic inflammatoire et intensité dépressive n’est significative que chez les mauvais dormeurs (β = 0,33 ; IC 95 % 0,26‑0,41 ; p < 0,001).
Aucune réaction indésirable grave n’a été rapportée ; la tolérance de l’endotoxine demeure excellente, renforçant la validité du modèle d’endotoxémie expérimentale même chez des seniors. Un effet modérateur du sexe apparaît : les femmes présentent une sensibilité dépressive accentuée, sans pour autant expliquer la sur‑réactivité liée à l’insomnie.
De l’expérimental au lit du patient : nouvelles cibles de prévention
Menée à Los Angeles entre 2017 et 2022, l’étude profite d’un design rigoureux (randomisation, évaluation en insu, mesure horaire de l’humeur) et d’une population communautaire équilibrée en termes de comorbidités somatiques, mais elle reste monocentrique et majoritairement caucasienne, limitant l’extrapolation aux ethnies sous‑représentées. L’utilisation d’un essai aigu ne préjuge pas de la réponse à des inflammations prolongées, toutefois les auteurs poursuivent une cohorte prospective pour relier cette hypersensibilité à l’incidence ultérieure de véritables épisodes dépressifs.
Selon les auteurs, ces résultats invitent à surveiller de près l’humeur des insomniaques âgés lors d’infections, de poussées inflammatoires chroniques ou même après vaccination. Ils suggèrent aussi de privilégier des stratégies à double cible : traitement cognitivo‑comportemental de l’insomnie et modulation de la réponse inflammatoire (exercice régulier, alimentation anti‑inflammatoire, voire anti‑cytokines expérimentaux) afin de prévenir la dépression tardive. Enfin, l’endotoxémie contrôlée se révèle un outil sensible pour tester de futurs candidats pharmacologiques destinés à réduire la vulnérabilité dépressive liée au couple insomnie–inflammation.