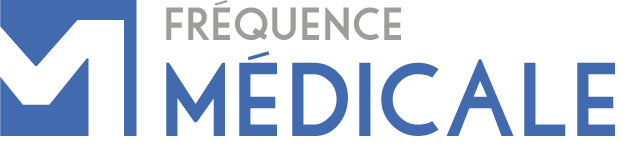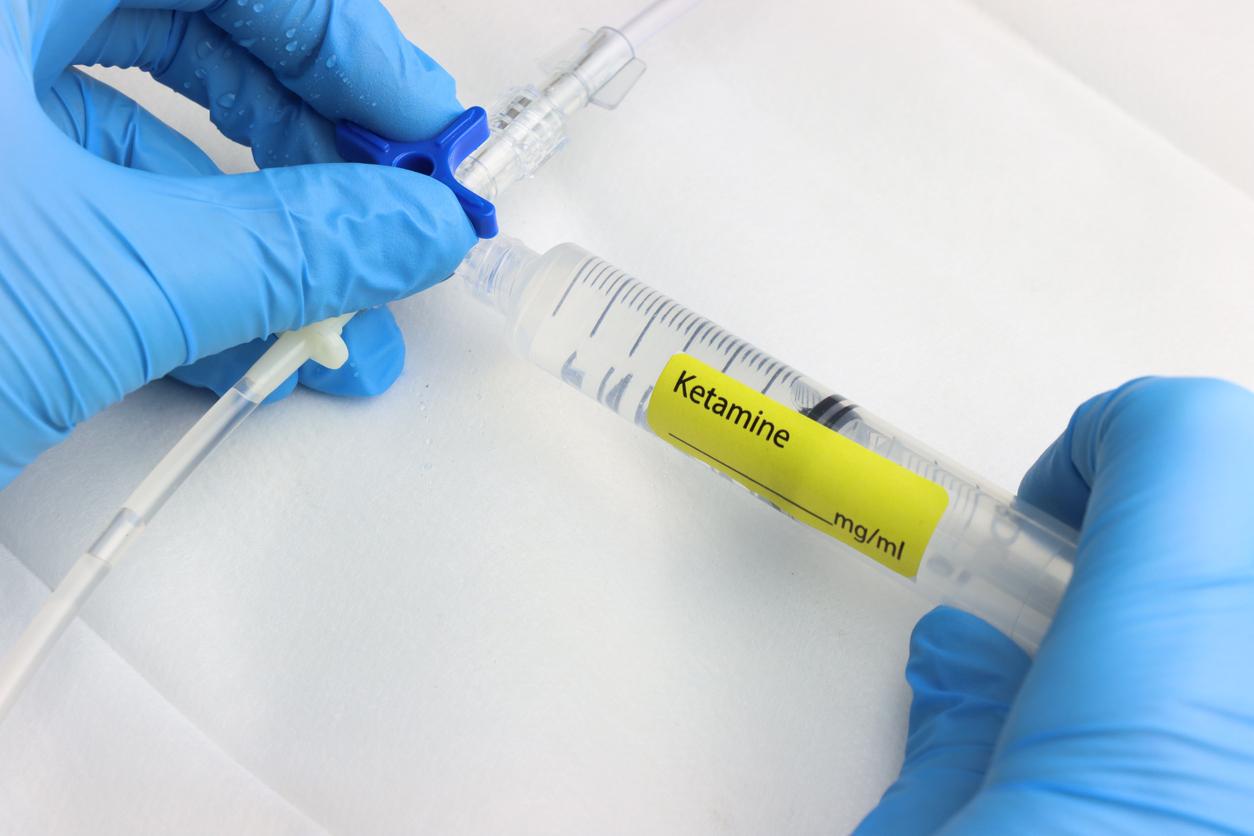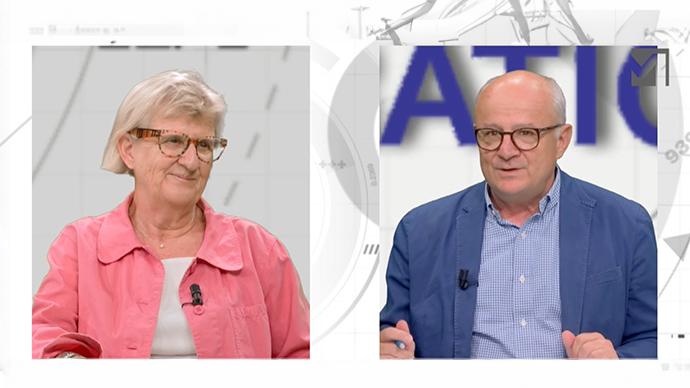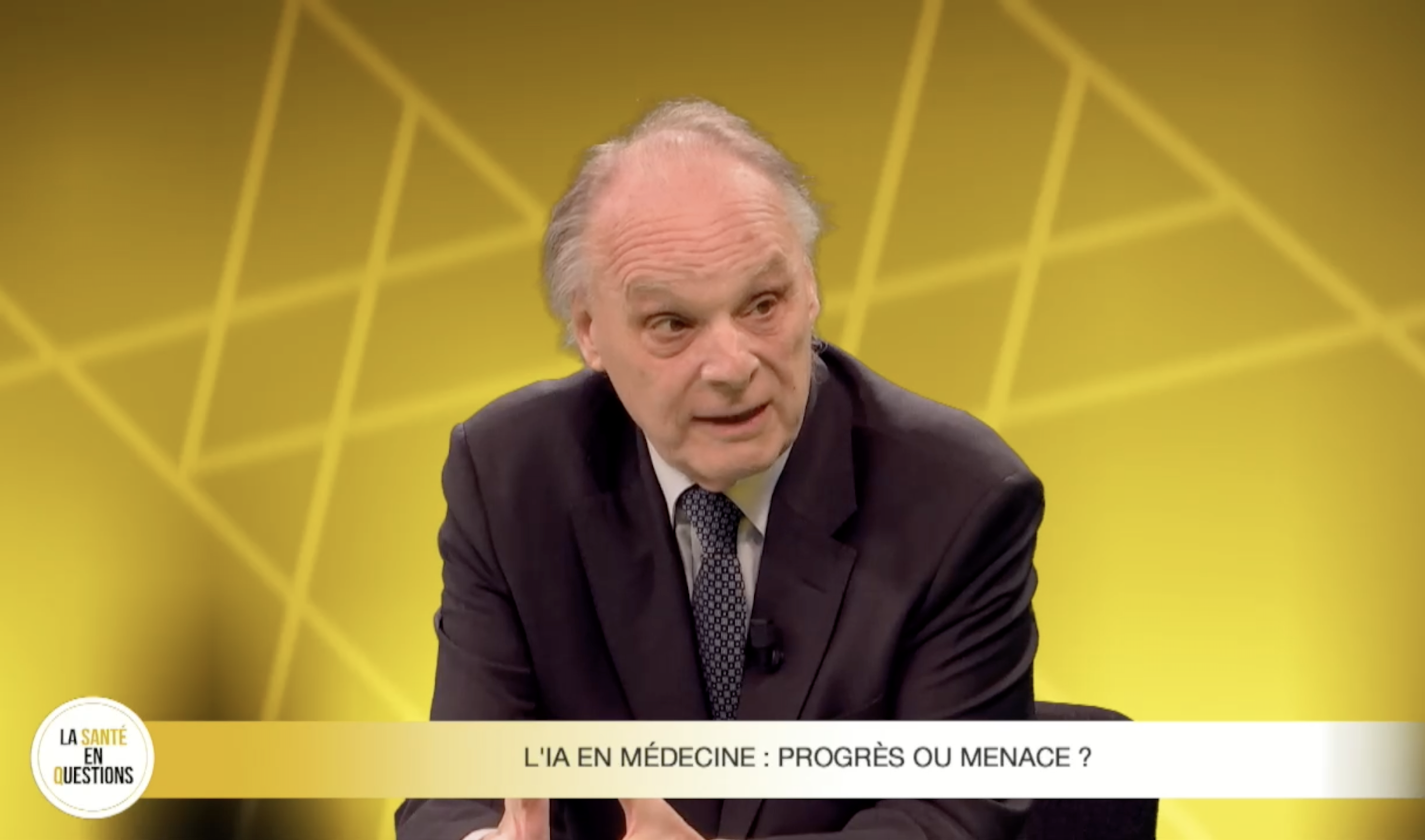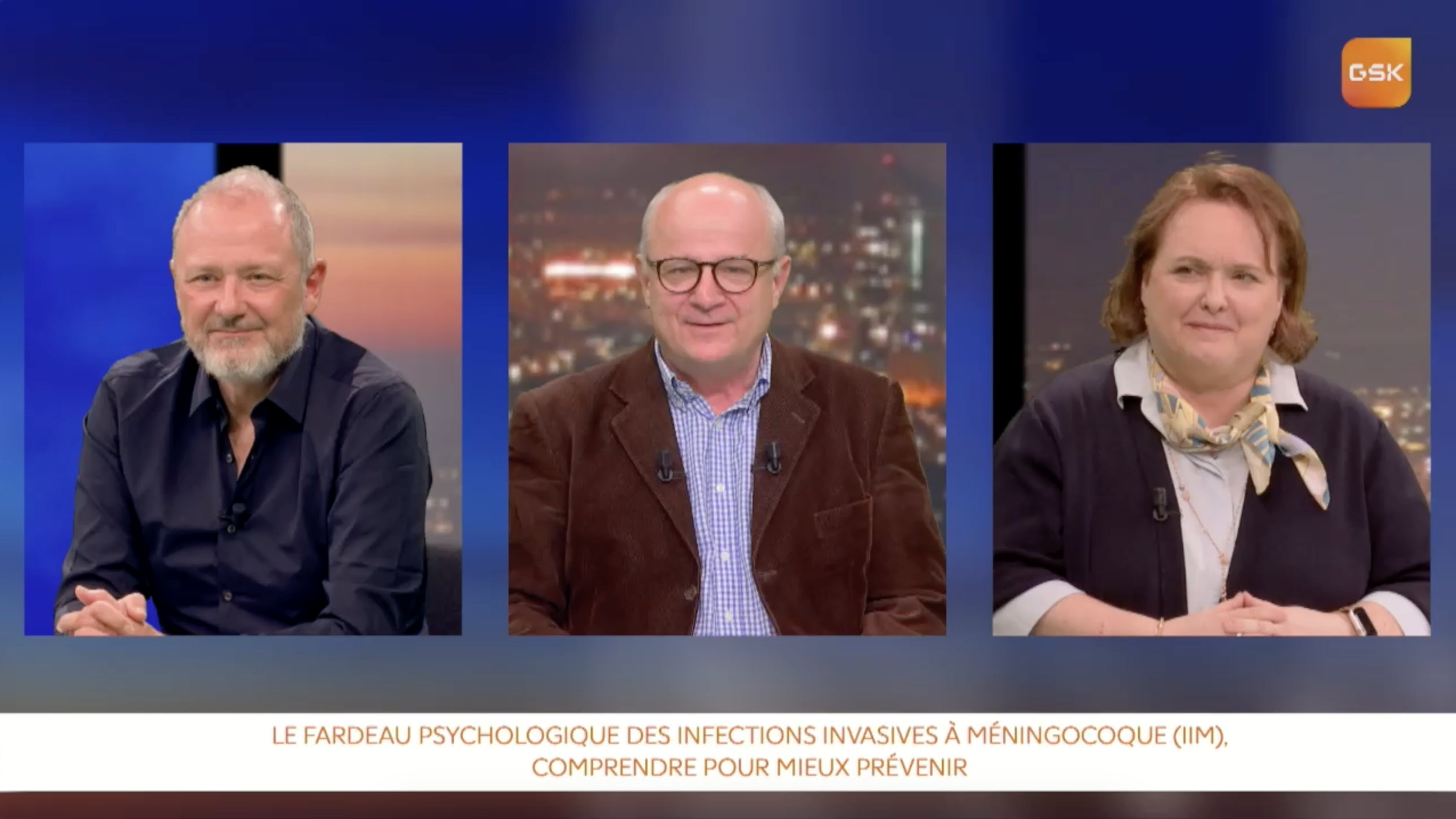Pédiatrie
Règles douloureuses à l’adolescence : un facteur de risque de douleur chronique à l’âge adulte
À 15 ans, l’intensité de la dysménorrhée (règles douloureuses) prédirait le risque de douleur chronique à 26 ans, avec une relation dose-effet indépendante des principaux facteurs confondants.
Ces données plaident pour dépister, expliquer et traiter tôt la dysménorrhée, en combinant options pharmacologiques et stratégies non médicamenteuses, afin de limiter la chronicisation.

- Satjawat Boontanataweepol/istock
La douleur chronique touche plus souvent les femmes à la naissance et ce différentiel émerge après la puberté. La dysménorrhée, extrêmement fréquente est souvent banalisée, pourtant, elle pourrait constituer un « premier événement nociceptif » dans une période de grande plasticité neurobiologique.
Selon les données publiées dans The Lancet Child & Adolescent Health, en exploitant la cohorte de naissance ALSPAC (Royaume-Uni), une analyse longitudinale montre qu’à 26 ans, 26,5 % des participantes rapportent une douleur chronique (≥3 mois). La sévérité de la dysménorrhée à 15 ans discrimine nettement ce risque : par rapport à l’absence de dysménorrhée, le risque relatif ajusté de douleur chronique est de 1,23 (IC à 95 % 0,85–1,74) pour une forme légère, 1,65 (1,22–2,18 ; p=0,0021) pour une forme modérée et 1,76 (1,23–2,39 ; p=0,0030) pour une forme sévère.
En termes absolus, l’excès de risque ajusté atteint +12,7 points pour une dysménorrhée modérée et +16,2 points pour une sévère, confirmant une relation dose–réponse cliniquement pertinente.
Au-delà du signal principal : phénotypes douloureux et facteurs psycho-comportementaux
La dysménorrhée à l’adolescence s’associe, dix ans plus tard, à des douleurs sur de nombreux sites (abdomen, rachis lombaire surtout, mais aussi tête, genou, poignet, hanche, cheville), ce qui suggère une vulnérabilité nociceptive systémique (sensibilisation centrale, altérations de réseaux cérébraux, modulation HPA/autonome).
En revanche, aucun gradient n’a été observé sur le nombre total de sites, plaidant davantage pour une augmentation de la probabilité d’expression douloureuse que pour une diffusion « type fibromyalgie » au même âge.
Des mécanismes plutôt biologiques que psychologiques
Les symptômes anxieux et dépressifs apparus après la dysménorrhée ne participent que pour une faible part de cette association, bien que leur contribution soit plus marquée en cas de dysménorrhée sévère : la trajectoire vers la chronicité semble donc dominée par des mécanismes biologiques de douleur plutôt que par la seule charge psychologique.
Un signal exploratoire suggère un moindre risque chez celles ayant débuté plus précocement une contraception hormonale efficace contre la dysménorrhée, sans permettre d’inférer une causalité.
Enfin, la prévalence de formes modérées/sévères à 15 ans est élevée (59,7 %), rappelant l’ampleur d’un besoin non couvert, alors même que la dysménorrhée retentit sur la scolarité, l’activité physique et la santé mentale, et demeure trop souvent banalisée par l’entourage comme par certains milieux scolaires.
Pourquoi s’intéresser à la douleur des règles chez l’adolescente ?
L’étude exploite ALSPAC, une cohorte populationnelle de naissance (livraisons attendues 1991–1992, région d’Avon), avec recueil annuel de la dysménorrhée de 8 à 17 ans, cotation de sévérité à 15 ans (nulle/légère/modérée/sévère) et évaluation de la douleur à 26 ans (« douleurs ≥ 1 jour dans le mois », ancienneté ≥ 3 mois définissant la chronicité). Ont été exclues les participantes avec douleur chronique pré-ménarche. L’analyse (n=1 157) a utilisé une régression logistique multivariée ajustée sur des facteurs de confusion présélectionnés (ethnicité, éducation maternelle, événements adverses de l’enfance, symptômes dépressifs pré-ménarche, activité physique, tabagisme, apports en AGPI à 10 ans, IMC à la ménarche), avec gestion des données manquantes par imputations multiples et exploration de médiations anxiété/dépression par bootstrap.
Les limites sont la mesure de la douleur par questionnaires (risque de mauvaise classification autour du seuil des 3 mois), l’absence de données fines sur traitements et l’autoprise en charge de la dysménorrhée, l’absence d’information détaillée sur causes viscérales (p. ex. endométriose), les possibles confusions résiduelles, et la population majoritairement britannique (généralisabilité à discuter).
Selon les auteurs, devant une adolescente avec dysménorrhée modérée ou sévère, la probabilité accrue de douleur chronique ultérieure justifie : une validation systématique de la plainte, l’éducation menstruelle et la remise d’un plan d’autogestion (AINS au bon timing, application de chaleur, activité adaptée), la discussion précoce d’options hormonales si besoin, le dépistage ciblé d’un trouble anxio-dépressif, et l’orientation gynécologique en cas de présence de « red flags » (douleur invalidante, non réponse, signes évocateurs d’endométriose/ adénomyose).
Au final, il semble pertinent de considérer la dysménorrhée à l’adolescence comme un signal d’alarme modifiable de la douleur chronique ultérieure, et d’agir tôt pour casser la trajectoire vers ce problème invalidant.