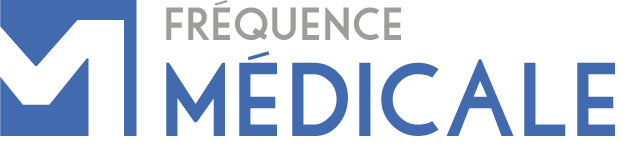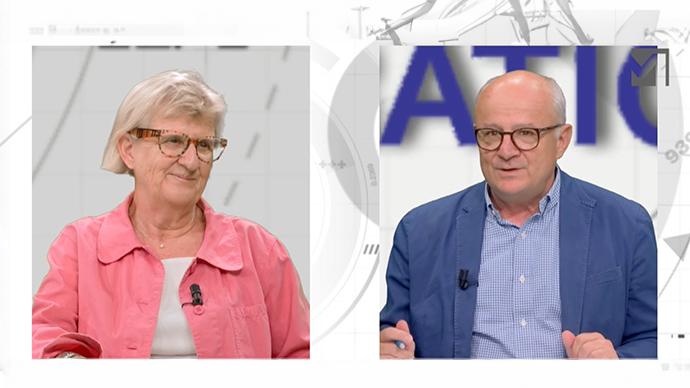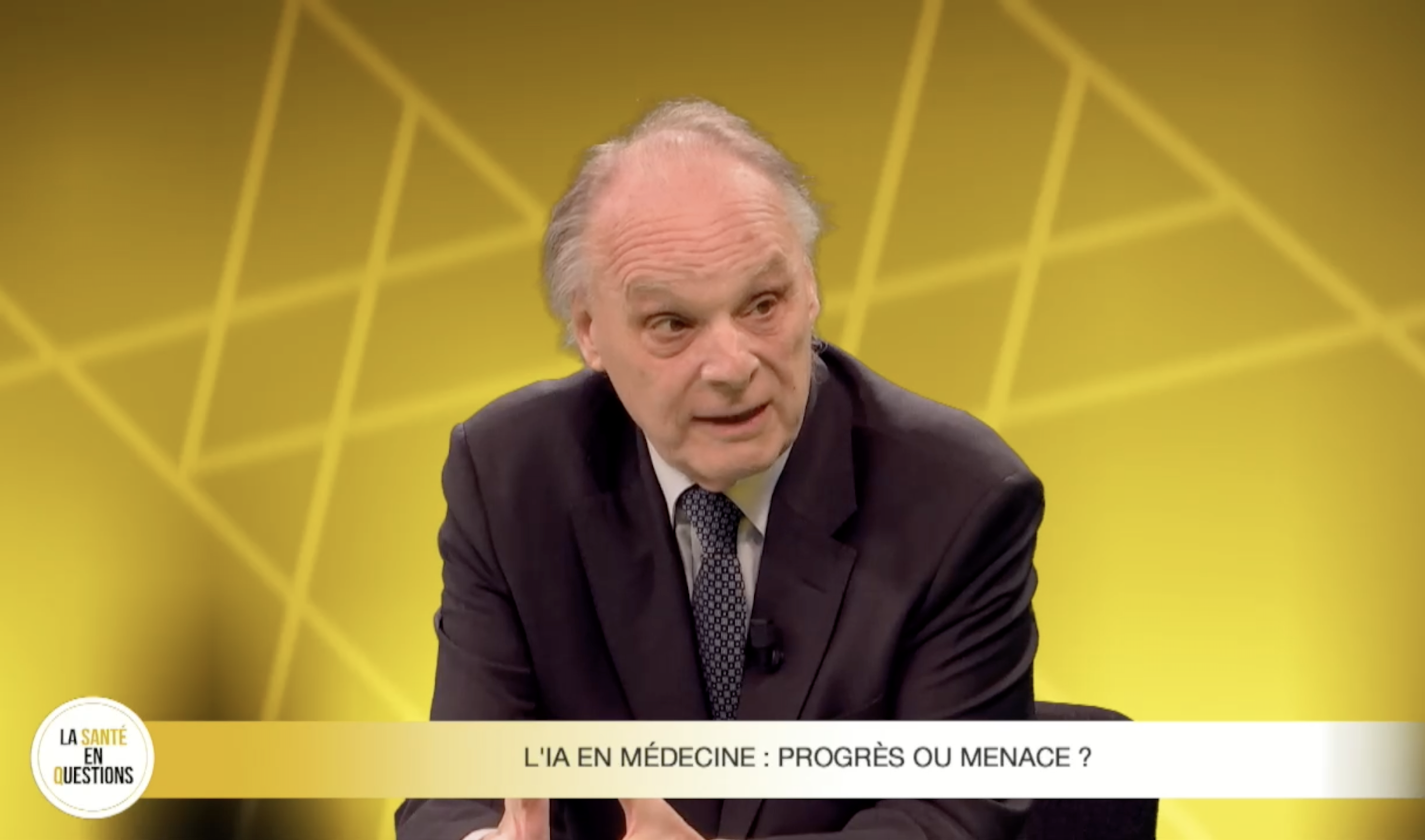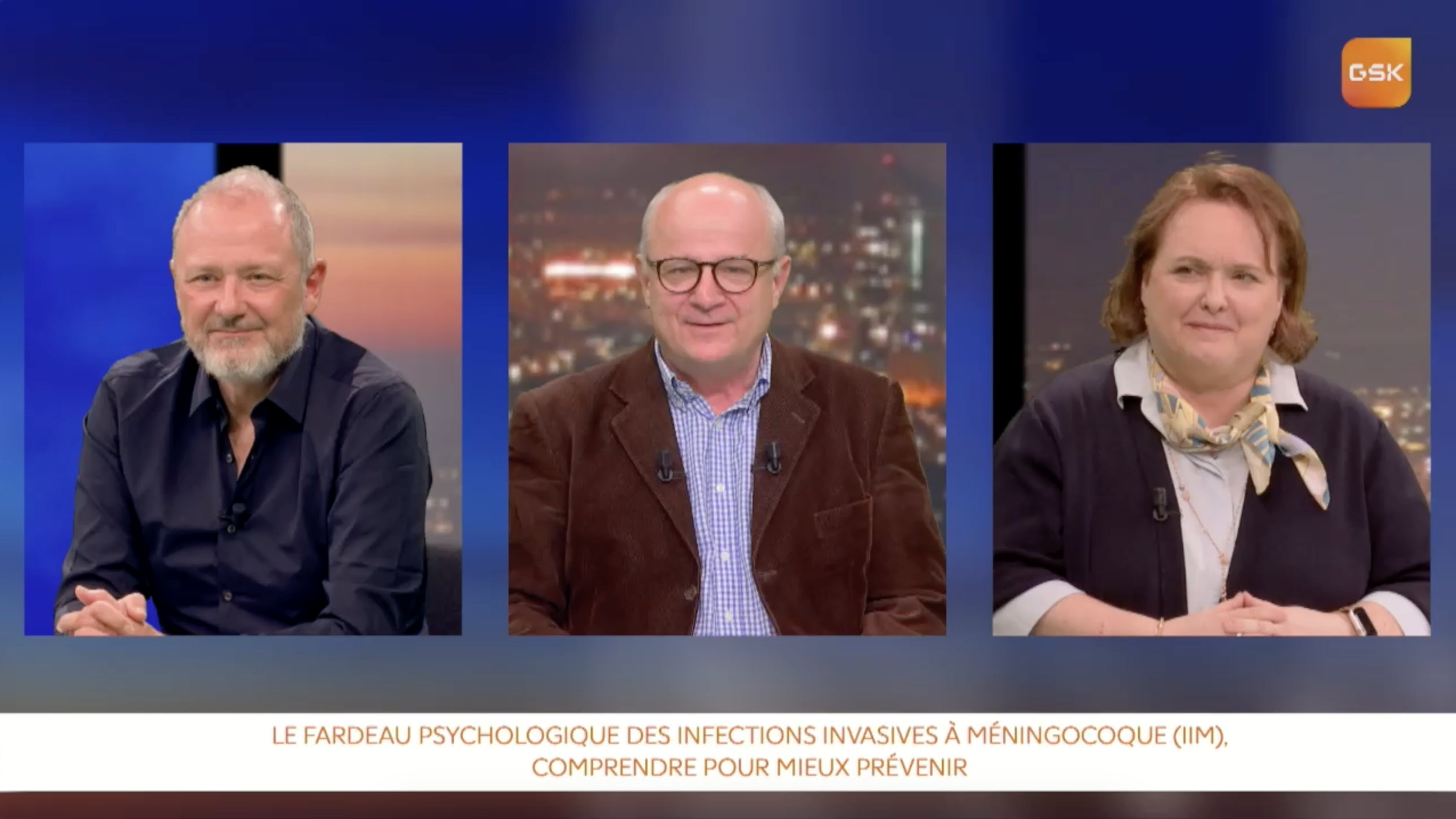Cardiologie
Hypertension résistante : efficacité de l’inhibition de l’aldostérone synthase
Chez des patients hypertendus non contrôlés ou résistants à une association triple, le baxdrostat, un inhibiteur hautement sélectif de l’aldostérone synthase, réduit la PAS d’environ 9–10 mmHg vs placebo à 12 semaines, avec un signal de natriurèse durable. La tolérance est globalement maîtrisable, ouvrant une alternative mécanistique aux antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes (ARM).

- Siarhei Khaletski/istock
La production inappropriée d’aldostérone, fréquente dans les phénotypes « sel-retenants » à rénine basse, contribue à l’HTA difficile à contrôler et aux lésions d’organes (fibrose, inflammation, atteinte vasculaire). Les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes (ARM) bloquent le récepteur minéralocorticoïde mais sont sous-utilisés en raison des hyperkaliémies et des effets endocriniens qu’ils provoquent et stimulent un rebond d’aldostérone. Le baxdrostat, inhibiteur hautement sélectif de l’aldostérone synthase (CYP11B2), s’attaque à la biosynthèse elle-même.
Présenté à l’ESC 2025 et publié dans le New England Journal of Medicine, l’essai de phase 3 BaxHTN, multinational, randomisé, en double aveugle, a inclu 794 patients avec PAS 140–<170 mmHg malgré ≥2 (HTA non contrôlée) ou ≥3 (HTA résistante) traitements dont un diurétique. Dans cette population, l’ajout de baxdrostat réduit la PAS assise de −14,5 mmHg (1 mg) et −15,7 mmHg (2 mg) à 12 semaines, vs −5,8 mmHg sous placebo ; la différence corrigée du placebo est de −8,7 mmHg (IC à 95 % −11,5 à −5,8) et −9,8 mmHg (−12,6 à −7,0 ; p<0,001 pour les deux). En pratique, 39,4 % des patients sous 1 mg par jour et 40,0 % de ceux sous 2 mg par jour atteignent une PAS <130 mmHg vs 18,7 % sous placebo, en sus d’un traitement anti-hypertenseur à base d’IEC/ARA, de diurétiques et souvent d’inhibiteurs calciques.
Au-delà de la baisse tensionnelle : cohérence physiologique, sous-groupes et sécurité surveillée
Les effets se retrouvent dans la plupart des sous-groupes préspecifiés, suggérant que l’excès d’aldostérone participe aux HTA non contrôlées comme résistantes. De façon exploratoire, l’aldostérone sérique baisse, l’activité rénine plasmatique s’élève et la PA ambulatoire diminue de façon concordante, compatible avec une majoration de la natriurèse malgré un traitement diurétique de fond et un possible « aldosterone breakthrough » sous blocage du SRAA. La phase de retrait randomisé (semaines 24–32) montre une remontée modeste de la PA : −3,7 mmHg sous baxdrostat 2 mg vs +1,4 mmHg après bascule placebo, alors que la clairance plasmatique est attendue en une semaine, suggérant un rééquilibrage lent des compartiments sodés et/ou des effets vasculaires/neuro-hormonaux.
Côté tolérance, une hyperkaliémie >6,0 mmol/L survient chez 2,3 % (1 mg) et 3,0 % (2 mg) vs 0,4 % sous placebo, conduisant à de rares arrêts ; une hyponatrémie légère (≈20 %) et une baisse moyenne précoce de l’eGFR d’environ −7 mL/min/1,73 m² ont été observées, cette dernière réversible après retrait. Ces événements, typiques d’une stratégie natriurétique/anti-aldostérone, sont surtout précoces, ce qui plaide pour un contrôle biologique à J7–14 puis à 4 semaines, particulièrement chez sujets âgés, IRC, ou sous associations hyperkaliémiantes.
Vers une « renaissance natriurétique »
BaxHTN est un essai de phase 3, multicentrique, en double aveugle, avec run-in placebo de 2 semaines puis randomisation 1:1:1 (baxdrostat 1 mg, 2 mg, placebo) pendant 12 semaines, sur une population représentative de l’HTA difficile (≥2/≥3 classes dont diurétique). Les limites incluent une mesure ambulatoire chez un sous-échantillon, une sous-représentation relative des femmes et des patients noirs hors Amérique du Nord, et l’absence de mesure objective continue de l’observance (bien que les dosages plasmatiques de baxdrostat la soutiennent). Ces éléments n’altèrent pas la robustesse du signal tensionnel et de sécurité à court terme, mais appellent des données prolongées sur la durabilité et les événements cardiovasculaires durs.
Selon un commentaire d’expert associé, l’inhibition de l’aldostérone synthase apporte une option mécanistique complémentaire des ARM. Elle s’envisage particulièrement chez les phénotypes « sel-sensibles » (obésité, sujet âgé, IRC), en cas d’intolérance/contre-indication aux ARM ou d’HTA persistante sous ARM, et possiblement en association séquentielle avec les autres stratégies natriurétiques (thiazidiques, iSGLT2, sacubitril/valsartan selon indication).
La mise en route doit s’accompagner d’une surveillance stricte du potassium, de la natrémie et de l’eGFR aux semaines 1–2 et 4, puis selon le risque, et d’un entretien diététique (sodium, apport potassique). Les prochaines étapes cliniques seront de définir les profils répondeurs (marqueurs biochimiques, rénine/aldostérone, phénotypes de rétention sodée), de préciser la hiérarchie vs spironolactone/eplérénone et de documenter, sur le long terme, la réduction des événements cardiovasculaires et rénaux.
Si la confirmation à plus long terme est au rendez-vous, les inhibiteurs de l’aldostérone synthase pourraient devenir un pilier de la stratégie « basse charge sodée » pour contrôler durablement la pression artérielle et atténuer les effets délétères de l’aldostérone au-delà du seul chiffre tensionnel.