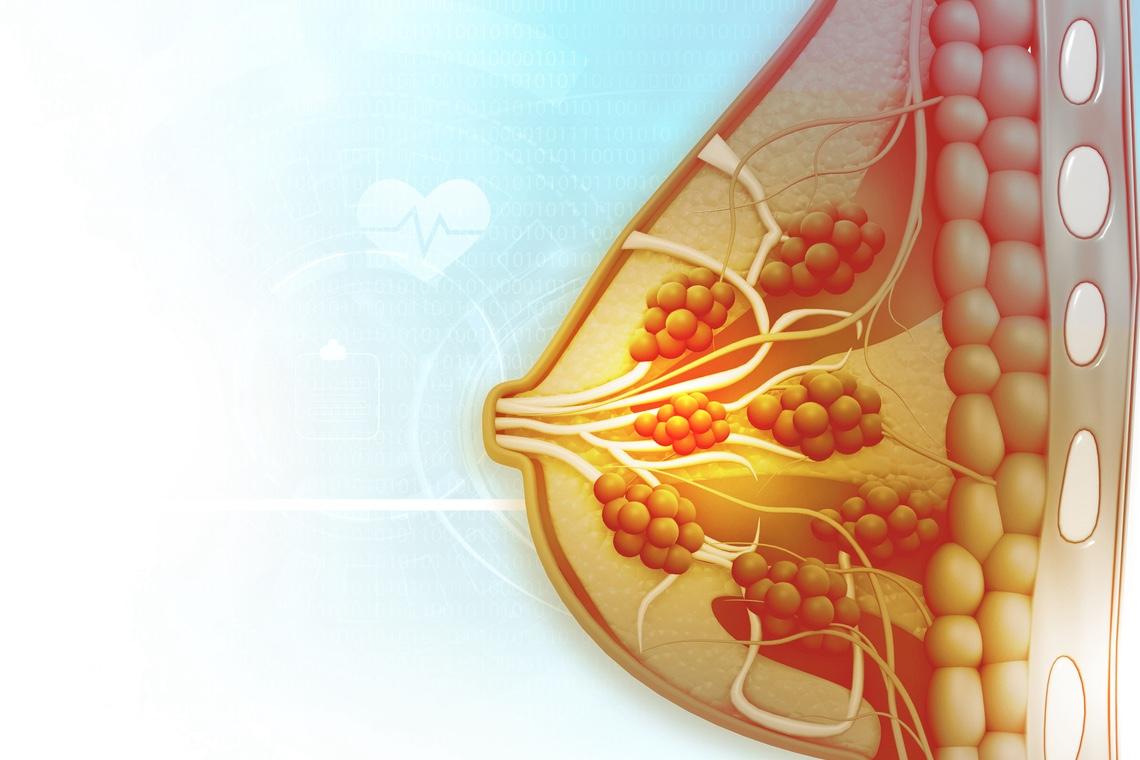Onco-Sein
Cancer du sein précoce : les chiffres du risque de second cancer 20 ans après
À 20 ans de suivi, l’excès absolu de risque de second cancer après un cancer du sein précoce reste modeste : environ 3 % pour le sein controlatéral et 2 % pour les autres localisations, avec un sur-risque plus marqué chez les femmes jeunes. Les associations observées avec les traitements adjuvants existent mais ne représentent qu’une faible part des excès, sans remettre en cause leurs bénéfices.

- SerhiiBobyk/istock
Dans un contexte de gains majeurs de survie pour les cancers du sein précoces, la question des seconds cancers prend de l’ampleur. Cette cohorte populationnelle anglaise a inclus 476 373 femmes âgées de 20 à 75 ans, diagnostiquées entre 1993 et 2016 et suivies jusqu’en 2021, après chirurgie initiale. Parmi elles, 64 747 ont développé un second cancer.
Selon les résultats publiés dans The BMJ, en approche de risques compétitifs, la probabilité cumulée à 20 ans d’un cancer non mammaire atteint 13,6 % (IC à 95 % 13,5–13,7), soit 2,1 points de plus que dans la population générale, et celle d’un cancer du sein controlatéral 5,6 % (IC à 95 % 5,5–5,6), soit un excès de 3,1 points.
Le sur-risque controlatéral est d’autant plus important que l’âge au diagnostic index est bas ; il croît aussi avec la taille tumorale et l’envahissement ganglionnaire. Pour les cancers non mammaires, les excès absolus à 20 ans restent <1 % pour chaque localisation prise isolément ; les contributions principales concernent l’utérus (non col) et le poumon.
Survivantes nombreuses, risques faibles mais quantifiés
Si certaines localisations rares ont des rapports d’incidence standardisée >1,5 (utérus, tissus mous, os/articulations, glandes salivaires, leucémies aiguës), leur poids absolu demeure faible. Les associations par modalités adjuvantes reproduisent globalement les signaux des essais : la radiothérapie s’accompagne d’une hausse des cancers controlatéraux et pulmonaires (et des sarcomes des tissus mous), l’hormonothérapie augmente le risque utérin mais diminue le risque de sein controlatéral, la chimiothérapie est associée aux leucémies aiguës et, dans cette analyse, à des hausses pour salivaires, gastriques, ORL et ovariens. Au total, environ 2 % de tous les seconds cancers et 7 % des 15 813 excès observés seraient attribuables aux traitements adjuvants.
Les tendances temporelles sont rassurantes : baisse des cancers de l’endomètre depuis 2005 (diffusion des inhibiteurs de l’aromatase) et diminution des cancers controlatéraux dans les périodes récentes. Sur le plan clinique, l’essentiel de l’excès global provient du sein controlatéral (60 %), surtout chez les plus jeunes ; cela plaide pour une vigilance prolongée de ce sein, une attention au phénotype lobulaire et, selon le contexte, une discussion de l’évaluation génétique. Les implications pratiques incluent aussi la minimisation des doses de radiothérapie sur le poumon et de la diffusion controlatérale, et un renforcement du sevrage tabagique, facteur de risque dominant pour le poumon.
D’où viennent ces chiffres et comment les traduire en pratique clinique ?
Il s’agit d’une étude observationnelle de registre national (National Cancer Registration and Analysis Service, Angleterre) de très grande ampleur et longue durée, avec corrections exhaustives des incohérences et une modélisation tenant compte des risques compétitifs. Les forces résident dans la taille, la granularité des caractéristiques tumeurs/patientes, et le choix d’estimer des risques absolus—les plus utiles pour la décision partagée. Limites : données incomplètes ou sous-déclarées pour certaines adjuvances, absence d’informations détaillées sur comorbidités, habitudes de vie (tabac, IMC), antécédents familiaux ; faible diversité ethnique ; impossibilité d’inférer la causalité et risque de détection différentielle. La comparabilité avec les essais randomisés montre des effets directionnels concordants mais d’ampleur souvent moindre, possiblement du fait d’adhérence thérapeutique et d’expositions hétérogènes en vraie vie.
Selon les auteurs, ces résultats doivent rassurer : pour une femme diagnostiquée à 60 ans, le risque à 20 ans d’un cancer non mammaire est de 17 % vs 15 % en population générale, et celui d’un controlatéral de 5 % vs 3 %. Chez une femme diagnostiquée à 40 ans, les risques à 20 ans sont de 6 % pour chacun des deux volets, vs 4 % et 2 % respectivement en population générale. Les traitements adjuvants contribuent faiblement à ces excès, et leurs bénéfices en termes de survie l’emportent très largement. Côté organisation du suivi, une extension ou une personnalisation de la surveillance du sein controlatéral chez les femmes jeunes pourrait être discutée, de même que des stratégies de radiothérapie limitant l’irradiation pulmonaire.
Les priorités de recherche portent sur l’actualisation continue de ces estimations à l’ère des nouveaux traitements adjuvants et des techniques d’irradiation, l’intégration de facteurs de mode de vie et de génétique pour affiner des algorithmes prédictifs, et l’évaluation coût-efficacité de durées de surveillance différenciées. En somme, l’excès absolu de seconds cancers existe mais reste modeste ; l’enjeu majeur demeure la guérison du cancer index, avec une prévention secondaire ciblée, pragmatique et informée par des chiffres réalistes.

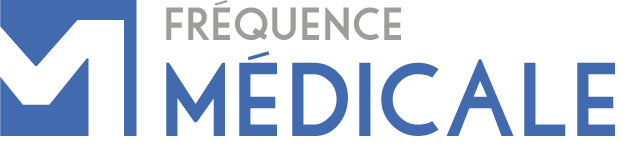


-1750339631.jpg)