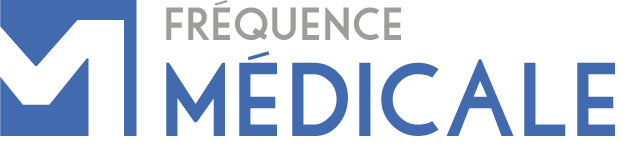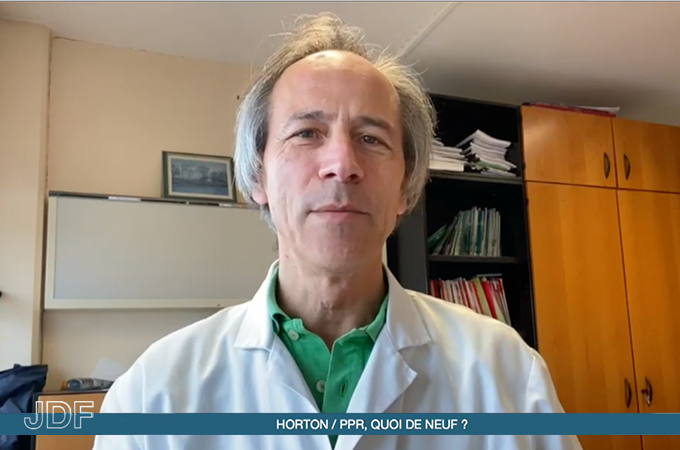Encéphalomyélite myalgique
Syndrome de fatigue chronique : une cause génétique ?
Une étude ADN met en évidence des signatures génétiques liées à l’encéphalomyélite myalgique, aussi appelée syndrome de fatigue chronique, une maladie invalidante mais longtemps ignorée.

- Par Stanislas Deve
- Commenting
- Rohappy / istock
C'est une avancée majeure pour une maladie longtemps déconsidérée : une équipe de chercheurs a identifié plusieurs régions du génome associées à l'encéphalomyélite myalgique (EM), aussi connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique (SFC). Cette pathologie débilitante, marquée par une fatigue extrême et des troubles cognitifs, toucherait des dizaines de millions de personnes dans le monde.
Une reconnaissance biologique de la maladie
Conduit par l’Université d’Edimbourg (Ecosse) dans le cadre du projet DecodeME, ce travail est la plus grande étude génétique jamais réalisée sur l'EM/SFC. Les chercheurs ont analysé l'ADN de plus de 15.000 patients, et l’ont comparé à celui de personnes en bonne santé issues de la biobanque britannique. Ils ont mis en évidence huit zones du génome, proches de gènes liés aux réponses immunitaires et neurologiques, notamment OLFM4, associé à la réponse antimicrobienne, ZNFX1, impliqué dans la réaction aux virus à ARN, et CA10, lié aux douleurs chroniques.
"C'est une validation de l'EM/SFC comme maladie biomédicale et un correctif important à la vision psychologique du ‘tout est dans la tête’", souligne Jos Bosch, épidémiologiste à l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas), dans un article publié dans la revue Science. Cette étude ne permet pas d’identifier une cause unique, mais elle marque une étape clé pour les patients dont les symptomes ont été longtemps ignorés ou mal compris.Un besoin de financement pour un séquençage complet du génome
Les résultats n’ont pas tous pu être reproduits dans d’autres cohortes, notamment à cause de critères diagnostiques différents. Chris Ponting, généticien humain et co-auteur de l’étude, insiste : "Ces divergences ne remettent pas en cause l’importance des signaux génétiques identifiés." Pour Doug Speed, généticien à l’Université d’Aarhus (Danemark), "ces variants n’expliquent qu’une petite fraction du risque, ce qui est habituel pour les maladies humaines". Plus de 85 % des participants ont accepté de partager leurs données pour d’autres projets. "Nos résultats apportent crédibilité et légitimité à l’expérience des patients", selon Sonya Chowdhury, directrice de l’association Action for ME, dédiée à la maladie. Mais elle affirme : "Nous avons un besoin urgent de financements pour passer au séquençage complet du génome." Si cette étude n'apporte pas encore de traitement, elle a le mérite de poser les fondations d'une meilleure reconnaissance de l'EM/SFC.